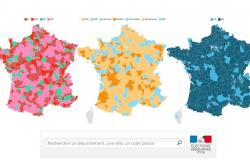Candidats au baccalauréat spécialisé Sciences Humaines, Lettres, Philosophie (HLP) a dû traiter un magnifique sujet philosophique cette année : « Pouvons-nous perdre notre humanité ? »
Nous avons demandé au philosophe Laurence Devillairs pour répondre à cette question, sous une forme libre. Voici sa réflexion inspirée.
« Comment pourrions-nous perdre ce qui nous définit ? Comment l’homme a-t-il pu faire pour ne pas être humain ? La question semble n’avoir aucun sens : perdre son humanité est une impossibilité. Mais justement, la philosophie remet en question ce qui semble impossible, à peine pensable. C’est ce qui rend son personnage à la fois inquiétant et visionnaire. Ce qui est troublant dans le questionnement actuel, c’est que l’humanité ne serait pas une caractéristique figée et inaliénable : on pourrait la perdre ou la retrouver. L’humain serait une histoire – une tragédie peut-être.
Ni ange ni bête mais constamment tenté par l’un et l’autre, l’être humain est ce qui peut manquer d’humanité. Soit il l’avale en jouant à la bête, soit il aspire à le surpasser en jouant à l’ange. Dans les deux cas, selon Pascalce qui nous manque c’est ça “fragile” “entre deux”dans lequel réside l’humanité, et qui “C’est la chose la plus fragile au monde” (Pensées, 1670, éd. par Ph. Sellier, 2000, fragment 185). L’humanité n’est ni un bien – obtenu une fois pour toutes grâce à l’éducation et à la civilisation – ni une donnée – qu’elle soit biologique ou culturelle. Elle pourrait donc se perdre. Ou reste-t-il inaliénable, même dans ce qui le viole ? Parce que seuls les humains peuvent se transformer en bêtes ou en anges. Faire le choix de ce qui le constitue.
La cruauté n’est-elle pas le désir de réduire un être à une « bête », au-dessous de l’animalité, voire à une chose ? Alors qu’est-ce qu’on perd ? Sa liberté et sa singularité, l’une étant la condition de l’autre. Réduit au rang de « bête », nous perdons notre dignité d’homme debout, bénéficiant d’un horizon au-delà du seul instant présent, et notre capacité à affronter, c’est-à-dire à juger, à refuser ou à acquiescer. . L’être humain réduit à l’état d’animal n’a plus de mémoire ni d’avenir ; il vit dans les limites étroites de la survie. Lorsque le jugement et la liberté lui sont refusés, l’homme devient une chose, sans fin ni même moyen, sans intériorité ni volonté.
Une chose ne compte pas. Il peut être brisé, utilisé et abusé. Ce qui est alors perdu pour l’humanité, c’est le “personnalité” dans le sens où Kant confère à ce terme, c’est-à-dire celui d’autonomie, de capacité à se déterminer, à vouloir pour soi : « La personnalité, c’est-à-dire la liberté et l’indépendance par rapport aux mécanismes de toute nature » (Critique de la raison pratique, 1788). Le bourreau perd aussi cette personnalité en la refusant à sa victime. Ce qui déshumanise est déshumanisé. Parce que nous sommes ce que nous nous donnons comme principe d’action, ce que nous respectons ou offensons. L’humanité dépend donc du bien et du mal, du meilleur et du pire dont les humains sont capables.
Il ne peut s’agir d’une caractéristique – biologique ou culturelle – puisqu’il s’agit d’une question morale, la façon dont nous interagissons avec ce qui est bien de faire et ce qui est mal de laisser se produire. Dès lors, l’humanité ne peut plus se perdre car elle est le choix absolu – dont rien ne peut nous exempter, et dont rien ne peut excuser – que nous faisons de nous-mêmes et que nous imposons aux autres. Il en est ainsi, selon les mots de Primo Levi, « la possibilité lointaine du bien » pour lequel ça vaut « rester humain »même au cœur de la barbarie, de la déshumanisation la plus extrême (Si c’est un homme1947).
Il peut alors s’agir de la beauté des choses qui rappelle à l’être humain son humanité, ou encore de l’attention d’un animal. C’est ce qui montre Emmanuel Lévinas dans un texte déroutant, où seul un chien est une personne : « Nous étions soixante-dix dans un commando forestier pour les prisonniers de guerre israéliens, dans l’Allemagne nazie. […] les autres hommes, dits libres, qui nous dépassaient ou qui nous donnaient du travail ou des ordres ou même un sourire […] nous a dépouillé de notre peau humaine. Nous n’étions qu’une quasi-humanité, une bande de singes. » (Liberté difficile1995).
Ce qu’ils avaient perdu n’était pas tant leur humanité que le monde, le fait d’avoir des relations et un ailleurs à imaginer, à se rapporter, pour lequel agir : «Nous n’étions plus au monde.» Mais dans ce désert, cette existence sans monde, “sale”un chien passe par là : “Nous l’avons appelé Bobby […] Il apparaissait aux réunions du matin et nous attendait à notre retour, sautillant et aboyant joyeusement. Pour lui – c’était indiscutable – nous étions des hommes. L’humanité peut être refusée ou bafouée, mais elle ne peut se perdre tant qu’il reste un être, un chien, pour rappeler que chacun nous est irremplaçable, une « personnalité » libre et fragile. »
Expresso : cours interactifs
Rousseau et la nature
Avec Rousseau, réconciliez-vous avec la nature humaine ! Quitte à tourner le dos aux progrès de la civilisation qui, finalement, nous éloignent de nous-mêmes.