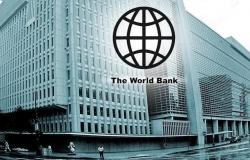En 2022, le rapport Basile-Bouchard sur les stérilisations imposées aux femmes autochtones a été accueilli comme un choc pour plusieurs, tandis que pour d’autres, il s’agissait plutôt d’un rappel douloureux d’une situation qui dure depuis des années. décennies. La chercheuse atikamekw Suzy Basile, qui prépare un deuxième rapport sur le sujet, prévient que le portrait est encore loin d’être complet.
Lorsqu’elle a débuté ses recherches en 2020, Suzy Basile s’est efforcée d’établir des relations de confiance avec des femmes victimes de stérilisation forcée ou de violences obstétricales. Au final, 35 d’entre eux lui ont raconté ce qu’ils ont vécu entre 1980 et 2019.
“En 2022, nous savions qu’il y avait plusieurs femmes à qui nous n’avions pas pu parler, à cause du COVID, de complications de voyage ou simplement parce qu’elles n’étaient pas prêtes”, “texte” : ” Lorsque nous avons publié le rapport en 2022, nous savions que il y avait plusieurs femmes à qui nous n’avions pas pu parler, à cause du COVID, de complications de voyage ou simplement parce qu’elles n’étaient pas prêtes. }}”>Lorsque nous avons publié le rapport en 2022, nous savions qu’il y avait plusieurs femmes avec qui nous n’avions pas pu parler, à cause du COVID, de complications de voyage ou simplement parce qu’elles n’étaient pas prêtes.
explique Mme Basile, qui travaille comme professeure à l’École d’études autochtones de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT).
Elle explique qu’avant même la publication du rapport, celui-ci avait été soumis à l’Assemblée des chefs des Premières Nations du Québec, qui avait donc a clairement indiqué que des recherches supplémentaires étaient nécessaires
.
Ce sont des sujets extrêmement sensibles, très personnels. Parfois, même la famille ou le conjoint ne le savent pas, cela peut donc être très compliqué.
souligne-t-elle dans une interview.
La professeure ajoute cependant que dès le début de ses recherches, une conjonction d’événements a poussé de plus en plus de femmes à se confier.
Le décès de Joyce Echaquan à l’hôpital de Joliette est également survenu en septembre2020, même si nous avons commencé les recherches au printemps de la même année. Cela démontrait clairement qu’il y avait des choses à observer dans le système de santé au Québec », « texte » : « Plusieurs avaient vu des rapports qui étaient produits au Québec et ailleurs au pays. Le décès de Joyce Echaquan à l’hôpital de Joliette est également survenu en septembre 2020, alors que nous avions débuté les recherches au printemps de la même année. Ça démontrait clairement qu’il y avait des choses à observer dans le système de santé au Québec”}}”>Plusieurs avaient vu des reportages réalisés au Québec et ailleurs au pays. Le décès de Joyce Echaquan à l’hôpital de Joliette est également survenu en septembre 2020, alors que nous avions débuté les recherches au printemps de la même année. Ça a bien montré qu’il y avait des choses à observer dans le système de santé au Québec
elle raconte.
Puis, avec la publication du premier rapport, les choses ont continué à s’accélérer. En 2023, un groupe de femmes atikamekw est devenu le premier au Québec à intenter un recours collectif contre des médecins qui auraient porté atteinte à leur fertilité sans leur consentement.
Cela a créé le bouche à oreille, les femmes se parlant entre elles. Nous avons également réussi à établir des relations de confiance avec le premier rapport, dans lequel nous avons anonymisé toutes les données. On ne reconnaît personne, on ne mentionne aucune communauté, donc ça aide
dit Mme Basile.
Le rapport publié en 2022 présente des données recueillies à partir des témoignages de femmes autochtones. Beaucoup d’entre eux n’ont appris que des mois ou des années plus tard qu’ils avaient subi une ligature des trompes.
Photo : Reportage Consentement libre et éclairé et stérilisations imposées des femmes des Premières Nations et inuites du Québec
Lors de la deuxième phase de la recherche, la majorité des personnes rencontrées ont contacté directement les chercheuses Susy Basile et Patricia Bouchard.
Nous venons de terminer le recueil des témoignages et nous espérons pouvoir publier le deuxième rapport l’année prochaine.
assure-t-elle.
Le sommet de l’iceberg
Pourtant, de plus en plus de femmes choisissent de parler de leurs expériences. Il demeure impossible pour Suzy Basile d’estimer le nombre d’Autochtones ayant subi des stérilisations imposées au Québec.
Les chiffres que nous avons pu recueillir jusqu’à présent ne sont que la pointe de l’iceberg, c’est certain. Nous savons qu’il y en a bien plus que celles que nous avons entendues. L’un de nos défis est l’incapacité d’accéder aux dossiers médicaux des personnes décédées, même à des fins de recherche. Nous entendons plusieurs morceaux d’histoire que nous ne pouvons pas confirmer.
La chercheuse atikamekw dit elle-même testé la machine
avec un membre de sa propre famille, aujourd’hui décédé.
Je crois [qu’elle] a subi une stérilisation. J’ai tout fait pour avoir accès au dossier médical, mais sans procuration, c’est impossible. Comme on ne peut pas faire signer une procuration à une personne décédée, je n’ai reçu jusqu’à présent que des réponses négatives, même en expliquant la situation.
Si on analyse la situation à travers le Canada, le bilan augmente considérablement. En 2022, la sénatrice Yvonne Boyer a présenté le projet de loi S-250 visant à modifier le Code criminel du Canada pour inclure les procédures de stérilisation forcée.
Encore une fois, il est impossible d’avoir un chiffre précis, mais, selon toutes les données recueillies par le sénateur Boyer, il y a eu des milliers de cas de stérilisation de femmes autochtones dans l’histoire du pays.
indique Suzy Basile.
Espoir pour l’avenir
Comme Suzy Basile, le chirurgien innu Stanley Vollant a fait partie du groupe de réflexion mis sur pied par le Collège des médecins du Québec pour explorer la question des stérilisations imposées.
Plus tôt cette semaine, le groupe a publié son propre rapport, visant principalement à formuler des recommandations sur la manière d’agir pour mettre fin à toutes ces procédures.
Il s’agit notamment de la mise en place, dès l’automne, d’une formation sur la sécurité culturelle des soins de santé. Même s’il ne faisait pas lui-même partie de la vingtaine de personnes mandatées pour mettre en place cette formation, le Dr Stanley Vollant se dit confiant quant aux conclusions.
Je connais bien plusieurs personnes qui ont été mandatées, notamment des médecins indigènes, et je suis convaincu qu’il y a eu beaucoup de réflexion et de travail.
il explique.
Ces dernières années, plusieurs professions ont mis en place des formations similaires, avec des résultats mitigés.
Ouvrir en mode plein écran
Le Dr Stanley Vollant est optimiste, même s’il reconnaît que les changements prennent du temps. «Mes enfants et petits-enfants verront une société dans laquelle les Autochtones auront accès aux mêmes services que les autres.»
Photo : Radio-Canada / Christian Côté
On est loin de celui qui a été mis en place par le gouvernement pour être donné aux infirmières. Cette formation, franchement, était pourrie. Là-bas, nous avons travaillé en collaboration entre autochtones et non-autochtones, et ce pendant une année entière
indique Stanley Vollant.
Il précise que même si elle ne sera pas obligatoire pour le moment, la nouvelle formation sera très attractive. Les médecins doivent suivre une formation continue et, pour cela, il existe un système de points dans lequel certaines formations valent plus que d’autres. Le Collège a veillé à ce que de nombreux points soient attribués à la nouvelle formation.
Le Dr Vollant déclare qu’il était Agréablement surpris
du degré d’engagement du Collège des médecins depuis la publication du rapport en 2022.
Il y a 15 ans, cela ne se serait pas passé ainsi et cela me donne de l’espoir. La médecine est un environnement plutôt conservateur, donc si nous commençons à faire de véritables pas dans la bonne direction, c’est un bon signe.
Même son de cloche du côté de Suzy Basile, qui soutient que l’écoute du Collège des médecins a été exemplaire. Dès la sortie du rapport, j’ai été contacté par le Collège pour voir ce qui pouvait être fait. J’ai ressenti une grande ouverture et, sincèrement, je pense que cela doit servir d’exemple aux autres institutions.