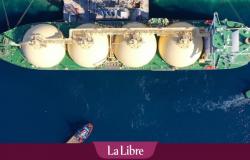Chaque Suisse consomme en moyenne 50 kilos de viande par an.Image : Shutterstock
Une consommation excessive de viande est nocive pour votre santé et pour la planète. C’est le cas en Suisse, où cette pratique est profondément ancrée dans les mentalités. Face à l’urgence climatique, les choses doivent changer, prévient un spécialiste. Et les mesures proposées ne plairont pas à tout le monde.
Le constat laisse de moins en moins de place au doute. La plupart des scientifiques s’accordent sur la nécessité de réduire la consommation de viande, du moins en Occident. D’une part, en raison des émissions polluantes qu’elle génère. Selon les calculs de l’ONU, la production d’un kilo de bœuf génère 35 fois plus de CO2 qu’un kilo de légumes. D’autre part, en raison des effets nocifs que cet aliment, notamment la viande transformée, peut avoir sur la santé.
L’idée fait son chemin, mais peine à s’implanter. Y compris en Suisse, pays où la consommation de viande est «très élevée en comparaison internationale», indique une étude récemment publiée par la Haute école bernoise des sciences agricoles, forestières et alimentaires (BFH-HAFL).
Selon les données relatives à l’année 2022, les Suisses consommaient en moyenne 50,8 kilos de viande par personne. C’est un montant trois fois supérieur à celui recommandé par la commission EAT-Lancet, composée d’experts internationaux en nutrition, santé et développement durable. Soit 301 grammes par semaine, maximum.
Le centre de nos assiettes
Comment expliquer cette forte consommation ? Il s’agit d’un comportement profondément ancré dans les mentalités, et qui trouve ses origines dans le passé, indique Mathilde Delley, collaboratrice scientifique à la BFH-HAFL et auteure principale de l’étude. « À l’origine, la viande était peu disponible, et donc rarement consommée, principalement pour les grandes occasions », illustre-t-elle.
Les choses ont changé à partir du 19e siècle, avec le développement de l’agriculture et l’augmentation du niveau de vie. “La viande a commencé à être présentée comme un aliment excellent, n’ayant que des aspects positifs », poursuit le chercheur. « Sa consommation fut fortement encouragée pendant une grande partie du siècle suivant, pour finalement entrer dans les mœurs. »
« Manger beaucoup de viande est devenu une norme sociale, quelque chose de normal et donc de bon »
Mathilde Delley, BFH-HAFL
“Cette nourriture a acquis un statut très symbolique, lié à la richesse, à l’accès à un certain niveau de vie et à la générosité, et qui est toujours en vigueur auprès d’une partie de la population”, ajoute-t-il. Elle.
La façon dont il est préparé peut également jouer un rôle. «Contrairement à d’autres traditions culinaires, où la viande est coupée en petits morceaux et mélangée à des légumes, en Suisse, on a tendance à mettre un morceau entier dans l’assiette», explique le chercheur. Ce qui ne facilite pas la réduction des portions. A cela on peut ajouter le fait que notre « richesse relative » rend cette nourriture « financièrement plus accessible par rapport à d’autres pays ».
De grandes différences au niveau socioculturel
Son « goût difficile à imiter », ainsi que « la facilité avec laquelle elle se prépare », ont fait de la viande « le centre de notre assiette », résume Mathilde Delley. Ce qui a donné lieu à des « fausses représentations » :
“Si on demande aux gens de composer une assiette idéale, ils auront tendance à indiquer une portion de viande trop importante, sans vraiment s’en rendre compte”
Mathilde Delley, BFH-HAFL
Et ce, même si « les recommandations nutritionnelles actuelles, basées avant tout sur la santé, préconisent des quantités nettement inférieures ».
«En Suisse, on a tendance à mettre un morceau entier dans l’assiette. Un steak ou une côtelette a une taille donnée, qui ne peut pas vraiment être réduite », précise Mathilde Delley.Image : Shutterstock
Cet attachement à la viande n’est pas uniforme au sein de la population suisse. L’étude BFH-HAFL met en avant « des différences importantes au niveau socioculturel ».
«Les citadins sont plus progressistes sur ce sujet, tout comme les personnes de nationalité suisse et celles ayant un niveau d’éducation élevé»
Mathilde Delley, BFH-HAFL
Autre élément déterminant : le genre. « En général, les femmes mangent moins de viande, veulent manger moins et sont davantage convaincues par des arguments extrinsèques et moins égoïstes, comme le bien-être animal ou l’environnement », illustre Mathilde Delley.
« Nous voulons dicter nos façons de manger »
Malgré cela, force est de constater qu’à chaque fois qu’il est question de réduire la consommation de viande, les réactions d’indignation abondent. Sur les réseaux sociaux et dans les commentaires des articles, on déplore particulièrement le fait de vouloir « policer » ou « dicter notre façon de manger ».
La raison d’un tel tollé est très simple : « Les gens n’aiment pas qu’on leur dise comment se comporter », explique Mathilde Delley.
« Quand on touche à l’alimentation, on touche à l’identité, à la liberté individuelle. Et les gens n’aiment pas ça du tout.
Mathilde Delley, BFH-HAFL
“Ils peuvent avoir l’impression d’être privés de quelque chose, qu’ils doivent faire des sacrifices, qu’ils sont les victimes de ces politiques“, Elle ajoute. Et ce, même s’il n’est pas question que tout le monde devienne végétarien ou végétalien, contrairement à ce que suggèrent certains commentaires.
« Certains constituants de la viande rouge sont bons pour la santé, voire essentiels, et difficiles à trouver ailleurs. C’est un fait», affirme Mathilde Delley. “Mais il n’est pas nécessaire d’en consommer massivement.”
« Ce qui est mauvais, tant pour la santé que pour l’environnement, ce n’est pas la viande en tant que telle, mais sa surconsommation. Et, aujourd’hui, on en consomme beaucoup trop”
Mathilde Delley, BFH-HAFL
Des mesures « radicales »
Alors réduisez, ne vous arrêtez pas. Un message clair, mais pas suffisant, selon le chercheur. “Adopter un message ferme et honnête, que certains qualifieront à tort d’alarmiste, est le seul moyen de changer les choses, de passer d’une consommation excessive à une consommation adéquate”, estime-t-elle. Et d’ajouter :
« Si on dit qu’il faut juste réduire, les gens auront l’impression que ce n’est pas si grave, que le problème est presque déjà résolu »
Mathilde Delley, BFH-HAFL
C’est pour cette raison que les auteurs de la recherche estiment que « l’abandon volontaire » n’est pas efficace, du moins pour « parvenir à un changement rapide ». Alors que faire? L’étude recense certaines mesures « assez radicales », estime Mathilde Delley. Qui prévient : “Ils ne plairont pas forcément à tout le monde.”
L’objectif principal : « Changer la norme sociale, ce qui est considéré comme approprié, festif et culinairement intéressant », explique le chercheur.
Tout d’abord, en agissant au niveau des lieux de consommation subventionnés par l’État, qui devraient proposer des « menus adaptés ». Mathilde Delley développe :
« Un menu de base sans viande, des plats avec de la viande disponibles uniquement sur demande et des journées sans viande ni poisson »
Mathilde Delley, BFH-HAFL
L’éducation familiale à l’école, qui fait partie du programme scolaire de la plupart des écoliers suisses, serait une autre porte d’entrée. « On pourrait apprendre à construire de nouvelles assiettes, à cuisiner sans viande, à utiliser des substituts, des légumineuses », énumère le chercheur. « L’intérêt d’agir au niveau de l’éducation, c’est de pouvoir toucher toutes les classes sociales et tous les milieux, ainsi que les consommateurs de demain. »
Le commerce de détail pourrait également y contribuer, selon l’auteur de l’étude : « Réfléchissez aux produits à mettre en avant dans les magasins. Décider d’arrêter les campagnes publicitaires sur la viande, tout en donnant plus de visibilité aux alternatives.»
Ce type de mesures serait « relativement facile à mettre en œuvre », estime Mathilde Delley, qui reconnaît que « convaincre les branches serait un gros défi ». Toutefois, selon elle, le temps presse.
«En Suisse, nous préférons les incitations aux interdictions. Nous aimons le consensus. Le problème est que cette approche n’est pas très efficace, notamment face à l’urgence climatique.
Mathilde Delley, BFH-HAFL