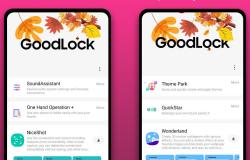J.La présidence d’Immy Carter est restée gravée dans la mémoire historique comme un échec. Ce jugement est curieux, surtout lorsqu’il vient des conservateurs américains ; Bon nombre des politiques préférées de la droite – la déréglementation et la lutte impitoyable contre l’inflation, quel que soit le coût du chômage – ont en réalité été lancées sous Carter. Bien sûr, plus ce malaise peut être associé au cultivateur de cacahuètes de Géorgie, plus son successeur, Ronald Reagan, le plus grand héros du conservatisme du XXe siècle, devient brillant.
Ce qui devrait être indiscutable, c’est que Carter a été le plus performant ex-président de la période d’après-guerre, et peut-être le plus grand ancien président de la période. Cela a beaucoup à voir avec sa pure intégrité. Mais le fait qu’aucun ancien directeur général après Carter n’ait réussi à imiter son modèle – en utilisant ses compétences et son accès pour faire des choses véritablement importantes en politique, plutôt que d’en tirer profit – en dit long sur notre époque.
Il s’agit certes d’un problème de luxe auquel la plupart d’entre nous ne sont pas confrontés, mais l’après-présidence mettra forcément n’importe quel homme politique dans une position délicate : soit l’un d’entre eux a été licencié par le peuple, soit frustré par la limitation des mandats. Une seule fois, un homme politique est revenu pour remporter la Maison Blanche après l’avoir perdue (Grover Cleveland) ; et il n’existe qu’un seul cas où un ancien chef de l’exécutif a réussi à obtenir autant de succès dans une autre branche du gouvernement (William Howard Taft, qui a été nommé juge en chef). Alors, que faut-il faire, à part écrire un livre que beaucoup achèteront mais que peu liront ? Ou, du moins, personne ne s’en souviendra : aucun aperçu mémorable n’a jamais émergé d’un mémoire présidentiel.
Carter a apparemment traversé une phase difficile et dépressive après avoir été vaincu par Reagan dans un glissement de terrain. Mais, âgé de seulement 56 ans à l’époque, il a décidé d’utiliser son talent et son importance pour améliorer la politique démocratique, accélérer ce qui aurait pu ressembler à un « processus de paix » plausible quelque part (en s’appuyant sur son succès encore inégalé avec les accords du Moyen-Orient à Camp David). ) et de s’engager dans une lutte mondiale pour éradiquer le ver de Guinée. Il fut le seul président du XXe siècle à retourner dans la maison (très modeste) dans laquelle il avait vécu auparavant ; comme l’a souligné un observateur, la maison a été évaluée à un prix inférieur à celui des véhicules des services secrets garés à l’extérieur.
D’autres ont emprunté des chemins différents : Ford avait déjà commencé à tirer profit de la présidence, notamment à travers des discours lucratifs ; il n’a cependant pas fait semblant d’appartenir à la jet set internationale. De toute évidence, il y a un danger à faire de telles observations, qui feraient simplement écho aux attaques incessantes de la droite contre les Clinton ; mais il n’en reste pas moins que voler dans l’avion de Jeffrey Epstein et prononcer des discours dans des entreprises de Wall Street à six chiffres font preuve d’un manque de jugement : ces décisions renforcent le sentiment qu’une classe politique vit dans un monde complètement séparé du nôtre. Même s’il n’y a pas de contrepartie directe (de toute façon, ce n’est pas vraiment ainsi que fonctionne le lobbying), parler pour de l’argent peut confirmer les soupçons selon lesquels les politiciens sont à vendre. Après tout, le secteur privé achète sa présence (« regardez qui nous pouvons trouver ! »), et non sa performance, et démontre ainsi son pouvoir.
Les anciens politiciens perdent du pouvoir, mais pas de leur influence, comme l’a dit un jour Bill Clinton. Ils peuvent vendre l’accès au plus offrant, ou lancer leur propre lobbying ou ce que l’on appelle parfois pudiquement une « société de conseil en investissement ». La justification selon laquelle certaines personnes extrêmement talentueuses ont opté pour le gouvernement et ont ainsi décidé de renoncer à des sommes d’argent massives – il est donc acceptable qu’elles en profitent plus tard – passe à côté de l’idée selon laquelle le service public devrait être une vocation et non quelque chose pour lequel on devrait s’attendre à des choses extraordinaires. une compensation financière plus tard.
Comme le fait remarquer un personnage du film classique de l’entre-deux-guerres, Les Règles du jeu, chacun a ses raisons. Clinton devait rembourser ses dettes après des années de procès ; George W. Bush a été tellement déshonoré par sa présidence désastreuse que toute tentative de jouer un rôle politique après 2008 aurait été, au mieux, accueillie avec dérision. Mais les observateurs ont peut-être eu l’audace d’espérer qu’Obama ferait un usage particulier de son prestige et de ses talents intellectuels. Hélas, les mémoires qu’il a écrites se sont révélées plates, ne parvenant pas à égaler la conscience de soi et la profondeur philosophique de ses livres précédents. Et faire un show en gambadant dans les Caraïbes avec Richard Branson sur l’île privée de ce dernier n’a pas seulement renforcé le sentiment que le glamour est une monnaie à laquelle on peut s’attendre après le dur travail de la présidence ; cela a également révélé l’hypothèse – partagée par Tony Blair, Gerhard Schröder et de nombreux autres dirigeants de gauche qui ont fait la paix avec le néolibéralisme – selon laquelle pour pouvoir faire quoi que ce soit d’efficace dans le monde, il faut s’associer à la richesse privée.
Carter a non seulement résisté au glamour, mais il a travaillé patiemment sur des projets bien choisis. (Contrairement à Clinton, qui, malgré ses extraordinaires compétences politiques et son sens aigu de la politique, a manqué de concentration dans ses années post-Maison Blanche, tout comme cela avait été le cas pendant sa présidence.) Il est vrai que Carter pourrait également être « engagé » dans une agence de conférenciers. – pour entre 100 et 200 mille dollars, dans la catégorie « Lifestyle » aux côtés des « Orateurs politiques ». Mais, dans l’ensemble, il a modélisé l’idée selon laquelle le service public n’est rien qui doive éventuellement être récompensé ou qui doit être rendu dépendant des riches ; c’est plutôt quelque chose qu’un individu peut sincèrement soutenir tout au long de sa vie.