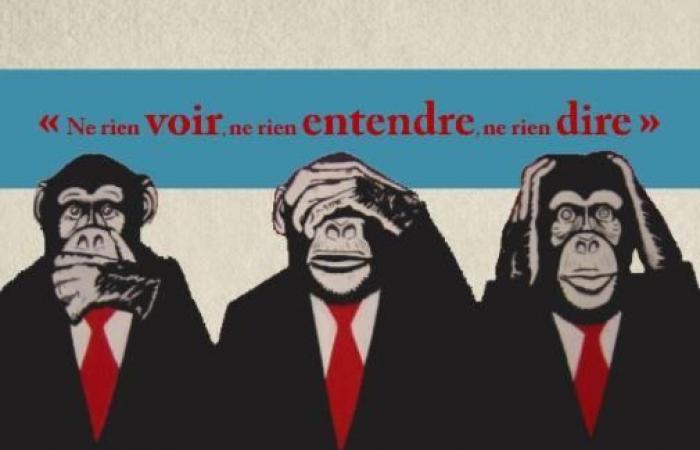Voici la meilleure réflexion reçue de notre aimable communauté qui réfléchit encore et c’est tellement rassurant ! Le sujet est bien posé, l’analyse toujours humaniste et bienveillante sans refuser de dire les choses.
Je ne peux donc m’empêcher de partager avec vous et avec son accord, son « œuvre » philosophique que je vous invite également à communiquer et à transmettre aux plus jeunes et étudiants de votre entourage.
C’est ainsi qu’on débat, c’est ainsi qu’on peut penser avec nuances et donc avec intelligence.
Bien réfléchir demande en fait beaucoup de travail. C’est ce que nous appelons la formation intellectuelle.
Vous verrez aussi que ces réflexions et ce texte nous rapprochent de la parabole des talents.
L’inégalité est-elle une injustice ?
Définitions
L’égalité est de deux ordres :
• Égalité des accidents
Deux individus ont la même propriété physique, le même poids, le même nombre, la même forme, la même localisation, etc. Il s’agit d’une relation quantitative. Il convient aux égalités arithmétiques.
• Égalité de fond
De même nature : deux individus de même nature ont une dignité identique. C’est une relation d’être.
La justice, c’est donner à chacun ce qui lui est dû.
(L’injustice est le contraire).
Il est évident que deux individus ne sont jamais égaux dans le hasard (la matière sur laquelle repose leur nature se confondrait, s’il le fallait, ce qui n’est pas possible).
En revanche, il semble dans l’ordre des choses que deux êtres de même nature aient la même dignité. Il y a donc égalité de substance en raison de la nature qui leur est commune.
Prenons un exemple :
Comparons l’égalité de deux téléphones : l’un de 2010 et l’autre de 2024. Ils ont l’égalité en substance, mais ce n’est pas un hasard. Il est évident que le deuxième téléphone dispose de plus de puissance de calcul que le premier. Pourtant, les deux sont autant téléphoniques l’un que l’autre : ils ont en réalité la même nature.
Bien qu’aucun des deux téléphones n’ait une substance plus « digne » que l’autre, il est tout à fait juste de s’attendre à ce que le téléphone 2024 ait des capacités et des performances supérieures à celles du téléphone 2010.
Nous affirmons donc qu’il existe deux niveaux d’égalité, mais une seule justice. Étant donné que le téléphone 2024 a plus de capacité, il devrait avoir de meilleures performances. Redonner
à chacun donc son dû, conformément à ses dispositions.
L’égalité entre les hommes
Ainsi, deux hommes sont toujours égaux dans l’ordre de la dignité, mais pas dans l’ordre matériel, car ils présentent nécessairement des traits différents et ont leur propre personnalité.
Il en va de même pour les différences entre hommes et femmes. Il existe évidemment des différences comme la capacité à accoucher ou des différences de force physique.
Ces différences physiques n’enlèvent rien à la nature commune qu’ils partagent : la nature humaine.
Ils sont donc égaux en dignité. Cette égalité en dignité implique qu’ils aient des droits et des devoirs conformes à la morale et à la justice.
Répondre
L’inégalité du hasard n’a aucune influence sur l’égalité de substance.
D’un autre côté, les inégalités accidentelles génèrent un bien plus grand, celui de l’ouverture à la vie – au sens large : la capacité d’agir par soi-même. Nous avons plutôt vu en fait qu’il n’est pas possible que deux individus partagent exactement les mêmes accidents, puisque ces accidents définissent en principe l’individualité.
Ainsi, il est aisé de comprendre que la notion de justice ne s’applique pas dans les accidents de la personne, mais au contraire, en prenant en considération toute leur nature : leur substance.
On comprend donc vite que les inégalités d’accident permettent la vie de la substance, ce qui est un ordre de justice supérieur. Par exemple, il serait injuste qu’un homme ne puisse pas vivre…
Si l’on veut une vraie justice, il semble donc qu’il ne faille pas gommer les différences qui distinguent les individus de même nature, mais au contraire les prendre en considération pour que chacun réalise sa vie selon les dispositions qu’il a. afin que chacun accède à la même dignité qui lui est due.
Ainsi, il est profondément injuste de demander à une femme d’être un homme, à un apprenti d’avoir les mêmes attributs que son maître, à un pauvre d’avoir les mêmes ressources que les riches. De même, il serait profondément injuste qu’un riche ne propose pas davantage de ressources aux pauvres (emploi, etc.) pour les aider à sortir de leur condition. Où il serait tout aussi injuste qu’une personne capable gagne autant sans travailler qu’une personne moins capable qui travaille.
La justice consiste à demander ce qui est conforme aux dispositions de la personne. « À qui on a beaucoup donné, on exigera beaucoup, et à celui à qui on a beaucoup confié, on exigera davantage. » (Saint Luc, 12:48)
Solution
L’inégalité est-elle une injustice ?
Non, car on ne peut pas reprocher aux inégalités d’être à l’origine de l’injustice.
Notons tout d’abord que l’inégalité de substance entre deux individus de même nature n’a pas de sens. Car, par définition, s’ils ont la même nature, c’est parce qu’ils sont égaux en substance. L’idéologie qui considère que les individus de même nature n’ont pas une dignité égale s’appelle le racisme, dont est issu le nazisme.
Quant à la différence de nature entre deux individus (ex : un poireau et un poisson rouge), on ne peut pas la considérer comme une injustice puisque les deux êtres n’ont pas la même finalité. Ils ont une fin conforme à leur prédisposition (le poireau pousse dans la terre, et le poisson pousse dans l’eau). ️
Il en va de même pour la justice entre individus de même nature que leurs différences mènent à leur fin.
On peut donc adopter deux positions : l’une qui considère les différences comme une injustice et la provoque ; l’autre qui considère les différences comme nécessaires à l’exercice de la justice.
1. En cherchant à gommer les inégalités (accidentelles), nous nous référons au cas d’une idéologie qui la considère comme une inégalité de substance. En effet, si l’on cherche à gommer les différences, c’est parce que l’on suppose que la personne n’est pas digne d’être ce qu’elle est, qu’elle serait plus digne d’être selon une autre vision. que nous y projetons. Ainsi, on veut modifier l’individu pour qu’il corresponde à l’image
que nous voulons avoir.
C’est l’essence du combat LGBT : donner à chacun la liberté de devenir ce qu’il veut, sans chercher à savoir si sa nature tend vers une certaine perfection. Les différences sont alors insupportables à leurs yeux puisqu’elles montrent les limites de leur pensée : par exemple le fait que la femme accouche et non l’homme montre que l’on ne choisit pas ce que l’on est selon le seul bon vouloir de notre volonté. Effacer la différence entre hommes et femmes leur permet alors de justifier que nous choisissons indépendamment de la réalité d’être ce que nous voulons. De même, une idéologie qui consisterait à normaliser tous les êtres humains générerait
injustice, car par exemple, il serait injuste de retirer à un athlète des capacités qu’il n’a de toute façon pas lui-même choisies.
2. Soit l’inégalité est prise en compte pour adapter les exigences et les attentes de l’individu en fonction de ses dispositions. De cette façon, la personne est considérée simplement telle qu’elle est. Cette vision seule permet d’atteindre un ordre de justice supérieur. Elle est aussi vectrice de charité, d’humilité et d’autres vertus. Bref, c’est un vecteur de vie !
Ainsi, la véritable justice prend nécessairement en compte les inégalités des accidents pour amener les individus à une égale dignité, amenant avec cette même dynamique un ordre des choses bien plus grand ! En recherchant cette saine justice, des biens plus grands découlent de la seule réalisation de la justice recherchée.
1 Dans la philosophie réaliste (Aristote, Saint Thomas d’Aquin), chaque objet est une substance et un accident. L’accident désigne l’ensemble des aspects physiques d’un objet (forme, poids, taille, propriété chimique, etc.). La substance désigne quant à elle la nature individuelle de l’objet. C’est ce qui rend deux courgettes égales dans leur naturelles (elles sont toutes les deux autant courgettes les unes que les autres), mais elles ont des accidents différents (différentes tailles, poids, couleurs, etc.).
2 « C’est un acte de justice que de rendre à chacun ce que je suis », Saint Thomas d’Aquin, Somme de Théologie, Secunda secondes, q61, a1.