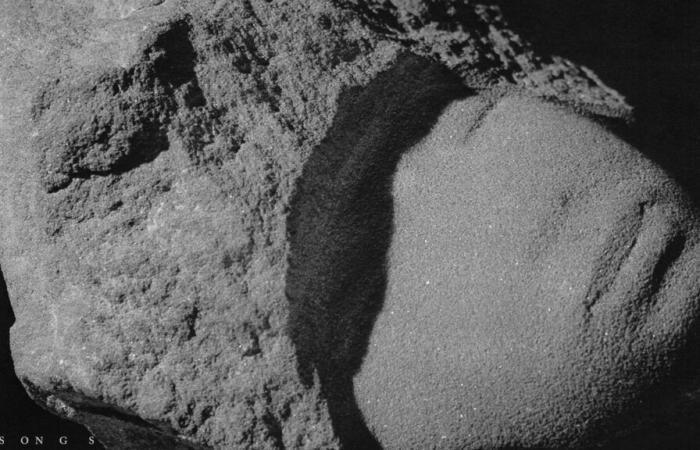L’intro droney et nico-esque de « Warsong » mise à part, vous auriez du mal à repérer de nombreux moments où les Cure se dépassent musicalement. Les lignes de basse de Simon Gallup sont uniformément robustes et basses, apportant le même dynamisme robuste qu’il offre de temps en temps depuis 1979 ; La batterie de Cooper a l’intensité saccadée et dirigée par les toms du travail de Lol Tolhurst sur Pornographie; et les mélodies de synthé fantomatiques de « Alone » et « Endsong » suggèrent la mélancolie magique de « All Cats Are Grey », des années 1981. Foi. Gabrels, le petit nouveau du groupe, avec seulement 12 ans de service, est le plus proche d’innover, même si ses feedbacks et son fuzz sur “Warsong” et le wah-wah torturé sur “Drone:Nodrone” rappellent inévitablement à l’auditeur à quel point les groupes shoegaze empruntés au Cure en premier lieu.
Contrairement, disons, aux Rolling Stones de 2024, les Cure d’aujourd’hui ne prétendent pas avoir besoin de prouver leur vitalité ou leur pertinence. Et pourquoi le devraient-ils ? On a parfois l’impression que nous devenons tous finalement The Cure, alors que les préoccupations éternelles – et initialement précoces – du groupe concernant la mortalité, le vieillissement et le doute s’infiltrent inévitablement dans nos vies à mesure que nous vieillissons et devenons plus fragiles. Et si nous devons nous plier au remède, alors pourquoi le remède devrait-il se plier à nous ? Le groupe s’est forgé son propre son – gothique, épique et pourtant étrangement minimal – et a gagné le droit d’y rester. Chansons d’un monde perdu semble épais et important, le chêne géant d’un album qui domine tout ce qu’il surveille. Chaque élément compte : chaque corde de basse pincée, chaque remplissage de batterie roulant, chaque grattement de guitare en colère ou chaque note de piano douce semble vitale.
Chansons d’un monde perdu ce n’est peut-être pas une grande amélioration en termes de qualité par rapport aux points forts de Fleurs de sang, 4:13 Rêveou quel que soit votre favori parmi les post-Souhait enregistrements. (Les opinions varient énormément.) Mais cela ressemble à un disque dont le moment est venu, délivrant une dose concentrée de The Cure et coupant le gras qui a harcelé leurs albums ultérieurs. Les huit chansons de l’album apportent des récits de mort très puissants (« I Can Never Say Goodbye » parle du décès inattendu du frère aîné de Smith, Richard) ; la mortalité (le magnifique « And Nothing Is Forever ») ; et la difficulté d’être dans le moment présent (« All I Ever Am »). La voix de Smith est toujours un instrument de libération remarquable après toutes ces années, et ses meilleurs distiques (« Et les oiseaux tombant de nos ciels/Et les mots tombant de nos esprits », de « Alone ») restent des merveilles d’économie. et l’artisanat.
Chansons d’un monde perdu ressemble parfois à la grande réflexion de David Bowie sur la mortalité, Étoile noire, bien que Cure prenne peu de risques stylistiques comme il l’a fait. Tout comme dans les dernières années de Bowie, on a souvent eu l’impression qu’un nouvel album de Cure n’arriverait jamais, l’élan du groupe étant fatalement stoppé par l’indécision des années 2000. Mais peut-être le plus grand compliment à faire Chansons d’un monde perdu c’est que cela semble déjà inévitable, une œuvre de sagesse et de grâce qui s’étend naturellement à partir du moment où le curé a pris ses instruments dans une salle paroissiale locale il y a toutes ces années.
Tous les produits présentés sur Pitchfork sont sélectionnés indépendamment par nos éditeurs. Cependant, lorsque vous achetez quelque chose via nos liens de vente au détail, nous pouvons gagner une commission d’affiliation.
The Cure : Chansons d’un monde perdu